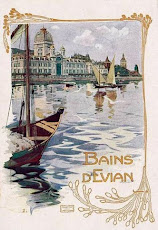Nous connûmes bien des sortes de romantiques. Il y en eut d'exaspérés, il y en eut de doux. La gamme descend de Victor Hugo à Gérard de Nerval. On n'en vit presque aucun, cependant, et pas même Alfred de Musset, abdiquer toute raison : le plus fou eut ses heures de sagesse, je veux dire des heures où l'intelligence reprenait le gouvernement de la sensibilité. Il n'y a qu'une exception : George Sand.
Nous connûmes bien des sortes de romantiques. Il y en eut d'exaspérés, il y en eut de doux. La gamme descend de Victor Hugo à Gérard de Nerval. On n'en vit presque aucun, cependant, et pas même Alfred de Musset, abdiquer toute raison : le plus fou eut ses heures de sagesse, je veux dire des heures où l'intelligence reprenait le gouvernement de la sensibilité. Il n'y a qu'une exception : George Sand.Je ne voudrais pas comparer Mme de Noailles à George Sand : elle ne le mérite pas encore tout à fait, et il faut espérer qu'elle ne le méritera jamais entièrement. Mais enfin, toutes deux sont femmes, et elles en abusent. Le mérite de Mme de Noailles est d'en abuser avec élégance. De plus, elle écrit dans une jolie langue, toute fraîche. Son style a des grâces et même des enchantements : la lisière d'un bois, le matin, avec un pré qui descend vers un ruisseau, et toutes sortes de feuilles, de fleurs, d'herbes, de bêtes, de bruits, de lueurs. George Sand, que Nietzsche a si bien nommée « la vache à écrire », écrivait en effet comme un ruminant ; le ruminant passionné n'en est pas moins un ruminant.
Quelques-uns des plus agréables écrivains d'aujourd'hui, en prose ou en vers, étant des femmes, il est difficile de prétendre que la femme n'est point faite pour la littérature. Si c'est pour elle un métier factice, est-ce donc pour l'homme un métier naturel ? L'homme, de même que la femme, est fait pour vivre sa vie et non pour raconter des vies qu'il n'a pas vécues. Il faut une grande habitude de la civilisation pour supporter sans rire l'idée qu'il y a à Paris deux ou trois mille créatures humaines qui vivent enfermées en de petites chambres, la tête penchée, les yeux vagues, une plume aux doigts. Cela est d'autant plus comique que le résultat de ces écritures, hâtives ou fiévreuses, demeure généralement inconnu. Les hommes persévèrent longtemps. Plus pratiques, les femmes désirent toucher rapidement le but. Chaque nouvel éditeur, chaque nouvelle revue, chaque nouveau journal voient venir à eux des martyrs de l'espoir littéraire qui avouent détenir en des tiroirs des douzaines de romans inédits. Il est très rare que les femmes soient aussi tenaces ; cependant, comme le nombre de celles qui écrivent s'accroît sans cesse, le moment approche où, aussi peu favorisées que les hommes, elles devront attendre et vieillir, en pleurant sur les moissons de leur génie.
Présentement, elles sont à la mode. M. Maurras en a compté quatre, dont le talent de poétesse ne le cède au talent de poète d'aucun de leurs contemporains. Quatre, c'est peu. Il y en a d'autres ; il y en a quatre ou cinq autres, au moins : je pense que les dieux ont voulu qu'elles soient neuf, comme les Muses. Presque toutes rédigent, alternativement des romans et des poèmes ; la plus célèbre est Mme de Noailles.
Si le romantisme pouvait renaître, l'auteur de la Domination en serait le thaumaturge. Aucun écrivain d'un talent égal n'a paru, depuis George Sand, qui se soit aussi follement laissé conduire par le sentiment et par le caprice. Peu d'hommes, même de ceux qui n'ont pas beaucoup de suite dans les idées, seraient capables de concevoir un roman aussi désordonné et aussi obscur que la Domination. Mais, concevoir ? Qu'y a-t-il de conçu en un tel livre, si ce n'est le titre et les premières pages ? C'est un gazouillis d'oiseau lyrique, et presque rien de plus. Il vole, cet oiseau, il plane, il redescend ; il nage alternativement dans tous les azurs, celui des cieux, celui des eaux, celui des âmes, celui des yeux.[...] La nature de Mme de Noailles semble être de s'arrêter à moitié chemin, de s'asseoir et de songer qu'il est doux d'avoir oublié le but de son voyage. Celui qu'elle vient de nous conter se perd dans les brumes qui ont caché au pèlerin la cime de la montagne, mais avec quel charme elle nous les décrit, ces baumes, et que d'azur encore jusque dans ces ténèbres !
La Nouvelle Espérance était l'histoire d'un égoïsme féminin ; la Domination aurait pu être l'histoire d'un égoïsme masculin : ce n'en est que l'ébauche, et à peine visible.
C'est un jeune homme qui se croit destiné à conquérir le monde. Son ambition touche à la folie : « Que mon jeune siècle s'élance comme une colonne pourprée, et porte à son sommet mon image ! » Ayant publié un livre qui est remarqué, il compare ses ivresses à celles qui, sans doute, au même âge, troublaient le « jeune Shakespeare ». Tout cela est exposé longuement, sans ironie aucune ; on croit à un essai de caricature, c'est une intention d'épopée.
Cet amant prématuré de la gloire se destine également à être l'amant de beaucoup de femmes :
« Les femmes, dit-il, ne me font pas peur. »
Une troisième ambition doit tenter un homme si ardent. Il médite avec émotion cette phrase célèbre : « César pleura lorsqu'il vit la statue d'Alexandre. » Alors, l'éclat de ces deux noms divins, ces larmes, et ce qu'il y a chez le héros d'humain et de surhumain fondirent le cœur du jeune homme, exaltèrent en lui l'orgueil et l'âpre volonté. »
Tel est le thème triple et unique du roman. On songe à Balzac. Mais Balzac lui-même recule. Il y a des limites au génie. Raconter les actes, développer la psychologie d'un homme qui va être à la fois Shakespeare, Don Juan et César, qui cela pourra-t-il jamais tenter ? Une jeune femme sourit avec nonchalance ; elle a lu des contes de fées où il arrive des choses encore plus merveilleuses. Mais dans la Domination, il n'arrive rien que des histoires d'amour. Le héros de Mme de Noailles n'est même pas Don Juan ; il est l'amoureux, le très ordinaire amoureux, celui des aventures qu'il est plus difficile d'éviter qu'il n'est glorieux de les avoir connues.
Depuis George Sand et Musset, Venise est le seul cadre qui convienne aux amours romantiques ; il faut, paraît-il, à certains épanchements, l'abri des gondoles. On ne peut pas être lyrique dans un compartiment de chemin de fer ; l'usage s'y oppose ; la gondole, cependant, autorise les plus sublimes divagations. Venise ! Là seulement on peut aimer avec distinction. Il y a aussi Bruges-la-Morte. Mme de Noailles n'a pas manqué de faire participer cette ombre illustre aux émotions de son héros. Héros, du moins, de l'impertinence, car, chose singulière, ce roman, écrit par une femme, respire le dédain de la femme, créature sans importance et qui n'existe que dans le désir de celui qui les aime. C'est une idée qui n'est pas tout à fait déraisonnable, et les femmes elles-mêmes semblent l'admettre, car elles sentent bien qu'elles ne vivent plus dès qu'on cesse de vivre pour elles. Elles ont encore plus besoin d'être aimées que d'aimer, encore qu'il leur soit cruel de détester qui les aime. Mais, vraie pour la femme, cette idée serait-elle fausse pour l'homme ? Si différentes que soient les manifestations extérieures de la sensibilité dans l'un et l'autre sexe, son essence est la même. On voit d'ailleurs, dans la recherche de l'amour, les femmes montrer une réserve qui prouve que leurs besoins d'affection ne sont pas irrésistibles. Les femmes se laissent séduire ; mais les hommes, bien plus encore, et bien plus facilement.
Voici les aphorismes de Mme de Noailles sur l'irréalité de la femme. C'est son héros qui parle, Antoine Arnault : « Oui, toutes les femmes, toutes ces princesses de la terre, elles ne peuvent que plaire, et, si elles ne plaisent point, elles sont mortes : voilà leur sort. Elles n'ont pas d'autre réalité que notre désir, ni d'autre secours, ni d'autre espoir. Leur imagination, c'est de souhaiter notre rêve tendu vers elle, et leur résignation, c'est de pleurer sur notre cœur. Elles n'ont pas de réalité, une reine qui ne plairait pas à son page ne serait plus pour elle-même une reine. »
On lisait dans un petit roman, paru il y a quelques années et que je ne nommerai pas : « Le privilège de vivre ! Mais vous seriez la seule, Hyacinthe, la seule entre vos pareilles ! Vous ne vivrez qu'en celui qui vous aura fait souffrir. » Les paroles de Mme de Noailles résument assez bien ce livre peu connu, et qui passa en son temps pour paradoxal. Cependant, comme toutes les femmes, elle exagère : et puis, ce n'est pas tout à fait la même chose de se réaliser dans la douleur ou de se réaliser dans le plaisir.
L'impertinence d'Antoine Arnault n'est ici que psychologique. D'autres hommes, qui ne le valent pas, ont sur les femmes des opinions plus bizarres encore et plus excessives. Où son insolence égoïste dépasse en horreur tout ce que l'on peut imaginer de la dureté grossière d'un amant repu, c'est quand il écrit, en la quittant, à une femme qui souffre déjà à cause de lui : « Quelle part de vous ai-je aimée en vous, je ne sais. Je me suis aimé moi-même sur votre douce et claire beauté. » Et ceci encore : « Oubliez-moi, et plus tard, si vous aimez l'orgueil, qu'il vous soit cher de penser que c'est vous que, dans Venise, Antoine Arnault a aimée... C'est vous qui chanterez dans mes livres au regard des jeunes hommes. Petite immortelle qui sans moi fût demeurée secrète, une dernière fois je vous contemple comme une créature vivante, et maintenant j'entre avec vous dans le jardin des souvenirs, âme endormie et divine... »
Seulement, la délaissée n'aura pas même la consolation, bien médiocre pour une femme qui aime, de figurer en quelque roman libertin, thème de descriptions trop claires, car Antoine Arnault n'écrira plus. Il se marie, devient amoureux de la sœur de sa femme et meurt en même temps qu'elle, sans que l'on sache de quoi, ni pourquoi, quand l'auteur, ennuyé de ce roman absurde, le clôt brusquement, sans aucune explication.
Des romans absurdes, il en paraît tous les ans des centaines ; mais celui-ci a cette singularité de déceler en même temps un très grand talent et même une sorte de génie du style. On s'est amusé à piquer, çà et là, dans ces trois cents pages, quelques phrases d'une correction équivoque : s'il fallait noter toutes les images délicieuses et neuves dont il est rempli, il serait plus court de transcrire le volume tout entier. Etant donnée l'incohérence de cette histoire, c'est du lyrisme intempestif, mais c'est du lyrisme.
Ainsi que le Visage émerveillé, on acceptera la Domination comme poème ; on en lira quelques pages, en oubliant qu'elles font partie d'un ensemble, car cet ensemble est incompréhensible.
« La sensibilité, a dit Maurras, à propos de la comtesse de Noailles, diffère de l'art ; mais elle est la matière première de l'art. » C'est très exact. Ici la matière première est restée à l'état naturel, ou à peu près. On ne nous a pas donné une œuvre d'art, mais seulement les éléments avec lesquels cette œuvre, si les dieux l'avaient voulu, aurait pu être édifiée. Ils ne l'ont pas voulu. Ils ont laissé la femme étouffer le romancier, et le sentiment étouffer dans la femme le peu de raison constructive dont son intelligence était capable.
Ne jugeons pas les femmes qui écrivent d'après les vieux principes, qui furent posés par des hommes, pour des hommes. Il ne faut leur demander que ce que leur nature leur permet de donner. Cela peut très bien être supérieur, en certaines parties, à ce que donneraient les meilleurs d'entre nous. Mais il est surtout nécessaire que cela soit différent. Voici une femme qui écrit sans se guinder à imiter le ton des hommes : c'est déjà un grand mérite, et c'est un grand charme. (rédigé en 1905)
----------------------
A consulter :
Léon-Paul Fargue, « Présence d'Anna de Noailles », Portraits de famille, J. B. Janin, 1947,
Jean de Gourmont, « Comtesse de Noailles », Muses d'aujourd'hui. Essai de physiologie poétique, Mercure de France, 1910





 Cette nuit-là, le compagnon ne fit que 'plonger trois ou quatre fois dans un mauvais sommeil tout habité d'obscurité glaciale, et l'aube le surprit au sortir d'un de ces sommes. Elle était là, collée à la bâche dont tout un côté s'éclairait. Tout de suite le compagnon fut debout, encore sceptique.
Cette nuit-là, le compagnon ne fit que 'plonger trois ou quatre fois dans un mauvais sommeil tout habité d'obscurité glaciale, et l'aube le surprit au sortir d'un de ces sommes. Elle était là, collée à la bâche dont tout un côté s'éclairait. Tout de suite le compagnon fut debout, encore sceptique.